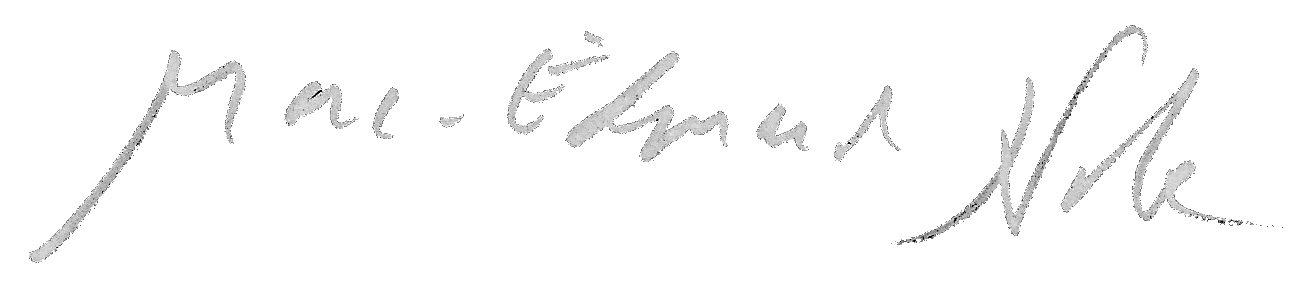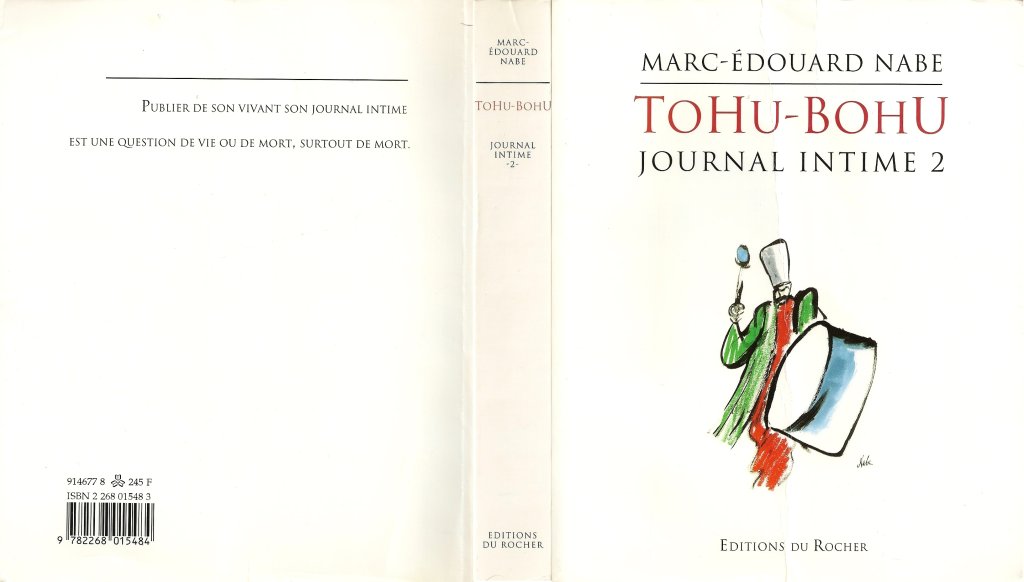
Genre : Journal Intime
Editeur : Éditions du Rocher
Date de parution : octobre 1993
Nombre de pages : 824
ISBN : 2-268-01548-3
Quatrième de couverture
Publier de son vivant son journal intime est une question de vie ou de mort, surtout de mort.
Extrait
Samedi 13 juillet 1985. – Vers quatorze heures, Hélène devine qu’ « il s’est passé quelque chose ». Je sentais l’imminence de la révélation depuis plusieurs jours où mon pauvre et lamentable secret m’alourdissait la poche stomacale. Je l’avais même surprise en train de lire mon journal. Ah, ce journal maudit ! Lui au moins (elle le sait) ne peut pas mentir ! On ne joue pas au plus malin avec la femme d’un diariste.
Sous un soleil splendide, assis sur un banc du boulevard Malesherbes, exactement à la hauteur de la maison natale de Raymond Roussel, je lui crache le morceau. Ce sont des pleurs immédiats. Nous remontons à l’appartement et là Hélène explose en une crise de nerfs enflammée qui tourbillonne mon amour dans le cauchemar. Elle devient folle, me frappe et m’arrache les lunettes. C’est comme une cuirasse qu’on lui enlève, une écorce qui éclate, une armure de chair déchirée de l’intérieur par la métamorphose d’un noyau. J’imagine comme tout doit s’écrouler en elle, tout doit disparaître : j’ai connu ça le 8 juin 1982 lorsque – même histoire – après quelques semaines, Hélène m’annonça en différé qu’elle m’avait trompé avec un prince de Belgique.
Fallait-il que ma connerie masochiste, mon sexualisme juvénile et ma misère morale soient encore frétillants pour qu’il y a trois semaines, au bord de la maîtrise, je cédasse à des circonstances qui ne pouvaient qu’immanquablement m’apporter sur un plateau la scène d’aujourd’hui ! C’est cher payer un vidage de glandes absurdes… Mais rien ne sert de se remordre : le repentir est encore confortable et je ne m’accorde, devant ce qui m’arrive, justement aucun confort possible.
Hélène est en larmes, la tête en masque grec agonisant. Elle ne sait plus ce qu’elle fait. Elle tourne en derviche hurleuse dans la cuisine. Elle esquisse un geste vers la fenêtre… Dans mon affolement, je crois qu’elle va se jeter dans le vide. Je lui saute dessus et la plaque au sol. Hélène halète, suffoque, n’arrive pas à respirer tant son désespoir l’étouffe : elle se débat pour me battre. Je panique si fort que d’une main je réussis à téléphoner au Samu. Quelques minutes après ce sont quatre grands gaillards de Police-Secours s’attendant à quelque sanglance qui déboulent rue Boissy-d’Anglas ! À l’aide de deux sanglots, Hélène retient un fou rire et s’excuse que j’aie pu les déranger pour « rien ». Ils repartent, nous conseillant d’aller nous rafraîchir la tête à la piscine Deligny. Le mépris que je me porte est grandiose. Tout doucement, Hélène, en me traitant de con, se redresse, se mouche, je lui donne un verre d’eau qu’elle laisse tomber sur sa robe de dégoût. Je la caresse en minimisant un incidant déjà sans importance : c’est le cliché de tout cocufieur, mais qui répond dans ce cas-là à la stricte vérité. Elle a besoin de détails et ma désinvolture l’agace et la rassure à la fois. Je la couvre d’arguments et lui rappelle ses frasques à elle, passées… Rien, pour l’instant ne peut parvenir à sa raison. Hélène est dans les brumes de ses fantasmes : les trois semaines que j’ai pu passer sans le lui dire ; le 22 juin dont j’ai souillé à jamais l’anniversaire ; la notion de couple qu’elle n’avait jamais eue si fort que ces derniers temps ; mon journal que j’ai écrit devant elle sans scrupule ; le panneau glandulaire dans lequel la Yankee m’a fait tomber ; le milieu intellectuel et parisien où j’ai choisi d’accomplir ma connerie colportable… Son orgueil, son invraisemblable orgueil reprend le dessus. Elle parle de me quitter. Elle ne peut plus avoir confiance en moi : une ou deux fois depuis son retour, elle fut traversée de doutes affreux que mon naturel dissipa : ce qu’elle imagine de pire arrive toujours : c’est son pif magistral de voyante épidermique… Je parviens à la porter au café le plus proche où nous abordons la phase philosophique de l’évènement. L’amour-propre salit toujours l’amour. Au bout de deux heures de sophismes et d’arguties, un très léger mieux se fait sentir : j’arrive à lui exalter le désarroi par mes fatalismes et mes sincères contritions. Ça retombe au restaurant où nos noires pensées nous guident. La diversion que provoque la rencontre hasardeuse de Leroy Bibbs (qui doit jouer le rôle de Herschell Evans dans le film de Tavernier) n’est pas très efficace. Je n’arrive pas à manger : un petit bout de canard à l’ananas manque de me faire dégueuler dans ma serviette. À un moment pourtant, Hélène sourit de la pitoyabilité de mes ficelles, du grotesque enfantin qui dévirilise mon hypocrisie. J’essaie de gagner, minute après minute, une pseudo-sérénité. Hélène est hachée menu à l’intérieur : ses sentiments sont en purée. C’est du hachis Parmentier tout son coeur. Elle tente de me trouver quelque excuse qui s’effrite illico dans la rage. Nous marcherons jusqu’à ÉPUISEMENT dans le Paris fêtard et hautement cafardeux de cette nuit de ballettis en délire. Comme par hasard, à nos psychismes dévastés par la déception et la culpabilité répondent les pétards, les rires et les tumultes d’une ville effervescente de trépidation populaire. En remontant la rue de Rivoli, surprenant sur le visage d’une femme qu’on ne peut pas tromper le rictus du vrai chagrin, je sombre au plus profond des gouffres de mon nihilisme. Hélène murmure, comme on prie, des résolutions funestes : l’idée ne passe pas. Les pétards nous suivent. On fait le tour de Paris en hagards masqués par la douleur. Partout c’est la fête : nous croisons des meutes en liesse et nous, nous sommes deux tubes parallèles, deux vases incommunicants. La fête bat son vide. On dirait que ce sont nos bustes qui explosent en feux d’artifice. Oh, la laide bleue ! L’horrible rouge, tout ce bouquet sanguinolent dans le ciel noir ! Giclures de cœurs ! Vers trois heures, j’arrive à la calmer assez pour qu’elle s’endorme. Je veillerai ses grincements de dents alors que dehors une dizaine de flics ont barré la rue pour le défilé de demain matin. Je ne dors pas et j’attends la benne à ordures qui arrive vers six heures dans un fracas de ferraille et de bouteilles : elle semble me broyer aussi, moi et toutes mes saloperies !
Un gros orage réveille Hélène : de grands tonnerres qui roulent dans l’aube, qui déferlent en cordes sur la Madeleine… Ça gronde : ma déesse cocue se tord dans les draps. Je la caresse. C’est un serpent blessé qui ondule sous les bruits de la pluie… Bientôt nous faisons un amour extraordinaire, un très long et très bel amour d’une demi-heure de danse voluptuo-douloureuse : une valse d’étaux. Depuis longtemps nous n’avions serré le désir ainsi. Ne serait-ce que pour ces deux quarts d’heure-là, ma misérable aventure s’avère presque utile. La banalité tragique des situations n’est souvent que la proposition d’une équation lumineuse. Les corps réagissent mieux aux « trahisons » que nous. Nous referons l’amour (« Ça me fait du mal et du bien à la fois » dit Hélène) encore plus tard, quand l’orage aura fait semblant de nous laver de tout.
Sous un soleil splendide, assis sur un banc du boulevard Malesherbes, exactement à la hauteur de la maison natale de Raymond Roussel, je lui crache le morceau. Ce sont des pleurs immédiats. Nous remontons à l’appartement et là Hélène explose en une crise de nerfs enflammée qui tourbillonne mon amour dans le cauchemar. Elle devient folle, me frappe et m’arrache les lunettes. C’est comme une cuirasse qu’on lui enlève, une écorce qui éclate, une armure de chair déchirée de l’intérieur par la métamorphose d’un noyau. J’imagine comme tout doit s’écrouler en elle, tout doit disparaître : j’ai connu ça le 8 juin 1982 lorsque – même histoire – après quelques semaines, Hélène m’annonça en différé qu’elle m’avait trompé avec un prince de Belgique.
Fallait-il que ma connerie masochiste, mon sexualisme juvénile et ma misère morale soient encore frétillants pour qu’il y a trois semaines, au bord de la maîtrise, je cédasse à des circonstances qui ne pouvaient qu’immanquablement m’apporter sur un plateau la scène d’aujourd’hui ! C’est cher payer un vidage de glandes absurdes… Mais rien ne sert de se remordre : le repentir est encore confortable et je ne m’accorde, devant ce qui m’arrive, justement aucun confort possible.
Hélène est en larmes, la tête en masque grec agonisant. Elle ne sait plus ce qu’elle fait. Elle tourne en derviche hurleuse dans la cuisine. Elle esquisse un geste vers la fenêtre… Dans mon affolement, je crois qu’elle va se jeter dans le vide. Je lui saute dessus et la plaque au sol. Hélène halète, suffoque, n’arrive pas à respirer tant son désespoir l’étouffe : elle se débat pour me battre. Je panique si fort que d’une main je réussis à téléphoner au Samu. Quelques minutes après ce sont quatre grands gaillards de Police-Secours s’attendant à quelque sanglance qui déboulent rue Boissy-d’Anglas ! À l’aide de deux sanglots, Hélène retient un fou rire et s’excuse que j’aie pu les déranger pour « rien ». Ils repartent, nous conseillant d’aller nous rafraîchir la tête à la piscine Deligny. Le mépris que je me porte est grandiose. Tout doucement, Hélène, en me traitant de con, se redresse, se mouche, je lui donne un verre d’eau qu’elle laisse tomber sur sa robe de dégoût. Je la caresse en minimisant un incidant déjà sans importance : c’est le cliché de tout cocufieur, mais qui répond dans ce cas-là à la stricte vérité. Elle a besoin de détails et ma désinvolture l’agace et la rassure à la fois. Je la couvre d’arguments et lui rappelle ses frasques à elle, passées… Rien, pour l’instant ne peut parvenir à sa raison. Hélène est dans les brumes de ses fantasmes : les trois semaines que j’ai pu passer sans le lui dire ; le 22 juin dont j’ai souillé à jamais l’anniversaire ; la notion de couple qu’elle n’avait jamais eue si fort que ces derniers temps ; mon journal que j’ai écrit devant elle sans scrupule ; le panneau glandulaire dans lequel la Yankee m’a fait tomber ; le milieu intellectuel et parisien où j’ai choisi d’accomplir ma connerie colportable… Son orgueil, son invraisemblable orgueil reprend le dessus. Elle parle de me quitter. Elle ne peut plus avoir confiance en moi : une ou deux fois depuis son retour, elle fut traversée de doutes affreux que mon naturel dissipa : ce qu’elle imagine de pire arrive toujours : c’est son pif magistral de voyante épidermique… Je parviens à la porter au café le plus proche où nous abordons la phase philosophique de l’évènement. L’amour-propre salit toujours l’amour. Au bout de deux heures de sophismes et d’arguties, un très léger mieux se fait sentir : j’arrive à lui exalter le désarroi par mes fatalismes et mes sincères contritions. Ça retombe au restaurant où nos noires pensées nous guident. La diversion que provoque la rencontre hasardeuse de Leroy Bibbs (qui doit jouer le rôle de Herschell Evans dans le film de Tavernier) n’est pas très efficace. Je n’arrive pas à manger : un petit bout de canard à l’ananas manque de me faire dégueuler dans ma serviette. À un moment pourtant, Hélène sourit de la pitoyabilité de mes ficelles, du grotesque enfantin qui dévirilise mon hypocrisie. J’essaie de gagner, minute après minute, une pseudo-sérénité. Hélène est hachée menu à l’intérieur : ses sentiments sont en purée. C’est du hachis Parmentier tout son coeur. Elle tente de me trouver quelque excuse qui s’effrite illico dans la rage. Nous marcherons jusqu’à ÉPUISEMENT dans le Paris fêtard et hautement cafardeux de cette nuit de ballettis en délire. Comme par hasard, à nos psychismes dévastés par la déception et la culpabilité répondent les pétards, les rires et les tumultes d’une ville effervescente de trépidation populaire. En remontant la rue de Rivoli, surprenant sur le visage d’une femme qu’on ne peut pas tromper le rictus du vrai chagrin, je sombre au plus profond des gouffres de mon nihilisme. Hélène murmure, comme on prie, des résolutions funestes : l’idée ne passe pas. Les pétards nous suivent. On fait le tour de Paris en hagards masqués par la douleur. Partout c’est la fête : nous croisons des meutes en liesse et nous, nous sommes deux tubes parallèles, deux vases incommunicants. La fête bat son vide. On dirait que ce sont nos bustes qui explosent en feux d’artifice. Oh, la laide bleue ! L’horrible rouge, tout ce bouquet sanguinolent dans le ciel noir ! Giclures de cœurs ! Vers trois heures, j’arrive à la calmer assez pour qu’elle s’endorme. Je veillerai ses grincements de dents alors que dehors une dizaine de flics ont barré la rue pour le défilé de demain matin. Je ne dors pas et j’attends la benne à ordures qui arrive vers six heures dans un fracas de ferraille et de bouteilles : elle semble me broyer aussi, moi et toutes mes saloperies !
Un gros orage réveille Hélène : de grands tonnerres qui roulent dans l’aube, qui déferlent en cordes sur la Madeleine… Ça gronde : ma déesse cocue se tord dans les draps. Je la caresse. C’est un serpent blessé qui ondule sous les bruits de la pluie… Bientôt nous faisons un amour extraordinaire, un très long et très bel amour d’une demi-heure de danse voluptuo-douloureuse : une valse d’étaux. Depuis longtemps nous n’avions serré le désir ainsi. Ne serait-ce que pour ces deux quarts d’heure-là, ma misérable aventure s’avère presque utile. La banalité tragique des situations n’est souvent que la proposition d’une équation lumineuse. Les corps réagissent mieux aux « trahisons » que nous. Nous referons l’amour (« Ça me fait du mal et du bien à la fois » dit Hélène) encore plus tard, quand l’orage aura fait semblant de nous laver de tout.
p.1147-1149